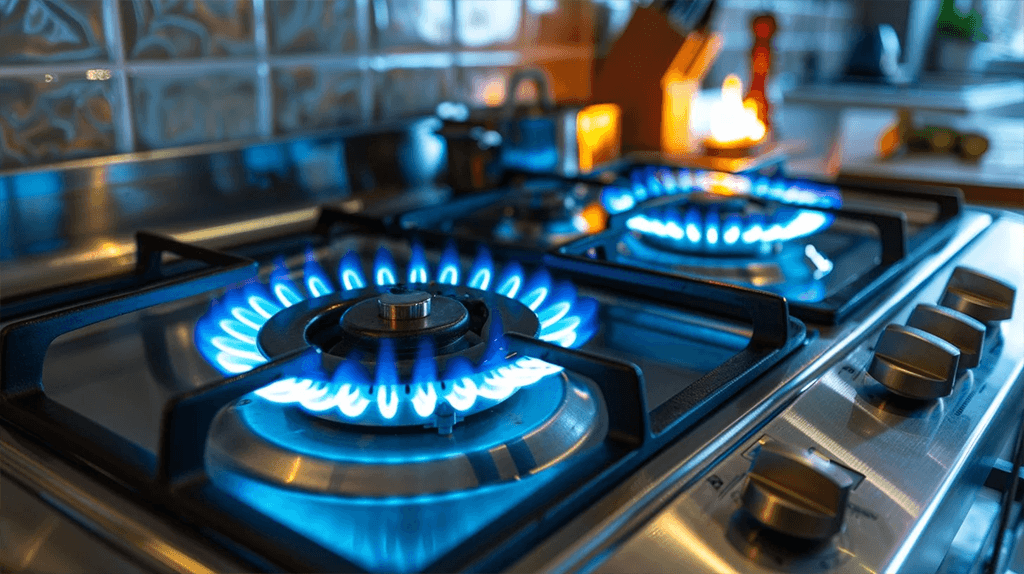
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et non irritant, ce qui le rend particulièrement dangereux car indétectable par les sens humains. Il est produit lors de la combustion incomplète de matières carbonées (bois, charbon, gaz, fioul, essence). Dans les environnements intérieurs, il provient principalement d'appareils de chauffage ou de cuisson défectueux ou mal ventilés. Ce gaz hautement toxique est la principale cause de décès par intoxication accidentelle domestique en Europe, avec plusieurs centaines de victimes chaque année.
Le monoxyde de carbone agit comme un poison sanguin en se fixant sur l'hémoglobine avec une affinité 240 fois supérieure à celle de l'oxygène, formant la carboxyhémoglobine (HbCO) qui empêche le transport d'oxygène vers les tissus. La prévention passe essentiellement par l'entretien régulier des appareils à combustion, l'installation de détecteurs de CO et une ventilation adéquate des locaux.
Le monoxyde de carbone représente un danger vital immédiat. En se fixant sur l'hémoglobine du sang, il bloque le transport de l'oxygène vers les organes et tissus. L'intoxication aiguë peut survenir en quelques minutes à fortes concentrations et entraîner la mort par asphyxie. Les symptômes évoluent avec le taux de carboxyhémoglobine dans le sang : maux de tête et vertiges (≥10% HbCO), nausées et fatigue intense (≥20% HbCO), troubles visuels et perte de conscience (≥30% HbCO), coma et décès (≥50% HbCO).
L'exposition chronique à faibles doses peut provoquer des séquelles neurologiques persistantes : troubles de la mémoire, difficultés de concentration, altération des fonctions cognitives, troubles de l'équilibre et symptômes psychiatriques. Les personnes ayant survécu à une intoxication sévère peuvent conserver des lésions cérébrales définitives, particulièrement dans les régions sensibles à l'hypoxie comme l'hippocampe et les noyaux gris centraux.
Toute personne disposant d'appareils à combustion dans son logement est potentiellement concernée. Les principales sources de monoxyde de carbone incluent :
Les situations à risque particulier comprennent :
Les symptômes d'une intoxication au CO ressemblent à ceux d'une grippe sans fièvre : maux de tête, vertiges, nausées, fatigue inexpliquée. La particularité est que ces symptômes touchent simultanément plusieurs personnes dans un même lieu et s'atténuent à l'extérieur. Une coloration rouge cerise des lèvres et des muqueuses peut apparaître dans les cas sévères, mais ce signe est souvent tardif. En cas de doute, l'évacuation immédiate et l'appel des secours sont impératifs.
Non, les détecteurs de fumée conventionnels ne détectent pas le CO car ils fonctionnent sur un principe différent (détection de particules). Seuls les détecteurs spécifiques de CO, conformes à la norme EN 50291, peuvent alerter en cas de présence de ce gaz. Il est recommandé d'équiper son logement des deux types de détecteurs pour une protection complète contre les incendies et les intoxications au CO.
La durée de vie moyenne d'un détecteur de CO est de 5 à 7 ans selon les modèles. Au-delà, le capteur électrochimique perd en fiabilité, même si l'appareil semble fonctionner. La date de remplacement est généralement indiquée sur l'appareil. Il est essentiel de respecter cette date et de ne pas se contenter de changer les piles. Les détecteurs qualitatifs (autocollants qui changent de couleur) ont une durée d'efficacité encore plus limitée (souvent 3 à 6 mois).
Le détecteur doit être placé à hauteur de respiration (1,5 m du sol environ) dans chaque pièce contenant un appareil à combustion, et dans les chambres à coucher proches de ces appareils. Contrairement aux détecteurs de fumée, les détecteurs de CO ne se placent pas au plafond car le CO se mélange uniformément à l'air. Évitez les emplacements trop proches des appareils de cuisson (fausses alertes dues aux émissions brèves normales), trop humides, ou exposés à des produits chimiques pouvant perturber le capteur.
Oui, tous les appareils à combustion, y compris les cheminées et poêles à bois, peuvent produire du CO, particulièrement en cas de mauvais tirage ou d'obstruction partielle du conduit. Le risque est accru avec les poêles anciens, les foyers fermés mal réglés et lors de feux couvants (manque d'oxygène). Le ramonage biannuel obligatoire, la vérification régulière des arrivées d'air et l'installation d'un détecteur de CO sont essentiels pour les utilisateurs de chauffage au bois.
L'utilisation d'un chauffage d'appoint à combustible non raccordé (pétrole, gaz) dans une pièce fermée, particulièrement une chambre, présente un risque élevé d'intoxication au CO. Ces appareils consomment l'oxygène de la pièce et rejettent du CO. Ils ne doivent être utilisés que ponctuellement, dans des pièces bien ventilées, et jamais pendant le sommeil. Pour une chambre, privilégiez systématiquement un chauffage électrique.
En cas de suspicion d'intoxication : (1) Ouvrez immédiatement portes et fenêtres pour aérer, (2) Si possible, arrêtez les appareils à combustion, (3) Évacuez toutes les personnes présentes, (4) Appelez les secours (112) depuis l'extérieur, (5) Ne retournez pas dans les lieux avant leur autorisation. Si une personne est inconsciente, sortez-la rapidement à l'air libre avant de pratiquer les gestes de premiers secours si nécessaire.
Le CO est un gaz légèrement moins dense que l'air qui diffuse facilement dans l'atmosphère. Il peut se propager d'un logement à l'autre à travers des gaines techniques non étanches, des conduits de ventilation communs, ou des planchers/plafonds présentant des défauts d'étanchéité. Une chaudière défectueuse dans un logement peut ainsi affecter les voisins, d'où l'importance d'une vigilance collective dans les immeubles, particulièrement ceux équipés de VMC collective.
Les intoxications graves au CO peuvent laisser des séquelles neurologiques permanentes chez environ 30% des victimes. Ces séquelles incluent des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, des problèmes d'équilibre, des tremblements, des troubles visuels et auditifs, ou des modifications comportementales. Un syndrome post-intervallaire peut également apparaître après une période de récupération apparente (2 à 40 jours), nécessitant une vigilance post-hospitalisation. L'oxygénothérapie hyperbare précoce peut réduire le risque de séquelles.
Il n'existe pas de valeur limite réglementaire spécifique pour le CO dans les logements en France, mais des valeurs guides sanitaires sont recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé : 10 mg/m³ (soit environ 8,7 ppm) pour une exposition de 8 heures, 30 mg/m³ pour 1 heure, et 60 mg/m³ pour 30 minutes. Dans le cadre professionnel, la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) est fixée à 20 ppm pour 8 heures.
